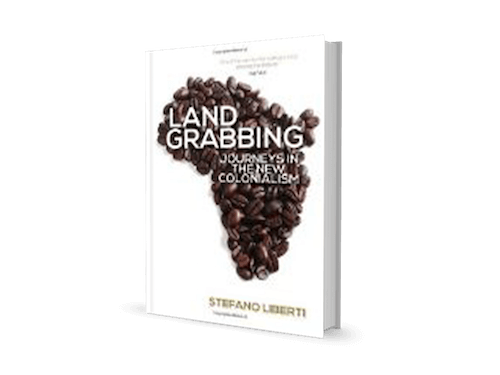
16 mai 2014
666 mots – Temps de lecture : 3 minutes
Mots clés
« Course à la terre »
Review
Ce livre est la version française d’un livre publié en 2011 par le journaliste italien Stefano Liberti. Il couvre un phénomène qui a attiré une attention croissante depuis 2008 : l’engouement pour l’acquisition de terres arables dans les pays de l’hémisphère sud.
Les acteurs de ce mouvement sont :
-des entreprises étrangères issues de pays riches (parfois soutenues ou même contrôlées par leur gouvernement) qui cherchent à y cultiver des produits alimentaires ou des biocarburants en vue de les exporter,
-des investisseurs, qui voient de plus en plus dans la terre un actif au futur prometteur, permettant également de diversifier leur portefeuille.
Chaque année depuis 2007, ce sont environ 10 millions d’hectares de terres arables qui ont ainsi été vendus ou mis en location de longue durée (des informations actuelles et détaillées sont disponibles sur www.farmlandgrab.org, un site qui recense toutes les acquisitions dans le monde).
La question essentielle que pose Liberti dans ce livre est : quelles sont les conséquences de cette “course à la terre”? Bien que le titre choisi donne une bonne indication de la réponse qu’il donne, il a fait l’effort de rencontrer toutes les parties prenantes au cours de son travail d’investigation, notamment des investisseurs et des responsables d’entreprises agro-alimentaires.
Liberti observe que l’acquisition des terres est soutenue ou même parfois initiée par les gouvernements des pays ciblés par les investisseurs, car ils y voient une opportunité de moderniser leur agriculture et de mieux s’intégrer aux marchés mondiaux. Un des cas les plus nets est celui de l’Ethiopie, qui poursuivrait l’objectif de mettre près de 3 millions d’hectares en location à longue durée (approximativement la taille de la Belgique).
Quant aux investisseurs et aux dirigeants de sociétés du secteur agro-alimentaire, ils parlent d’opportunités, de développement, de productivité et aussi de responsabilité sociale. Liberti dénonce certains d’entre eux comme de purs hypocrites, mais reconnaît aussi que d’autres ont une intention sincère de contribuer au développement économique des pays dans lesquels ils investissent.
Le problème essentiel est pour l’auteur que c’est surtout une catégorie de personnes qui fait les frais de ces acquisitions de terres : les petits paysans locaux, en effet expulsés de la terre qu’il cultivaient jusque-là. Dans le meilleur des cas (configuration plutôt rare), ils trouvent un emploi non-qualifié et peu rémunéré au service des investisseurs, comme les indiens Guarani au Brésil, mais le cas le plus fréquent reste qu’ils se retrouvent sans moyen de subsistance et viennent grossir les rangs du prolétariat urbain.
Les accords de cession sont souvent négociés dans l’ombre, sans compétition, avec des sociétés qui ont des connexions privilégiées avec les gouvernements locaux.
Ceux-ci assurent que les terres cédées sont inhabitées et inutilisées, mais la vérité est plutôt selon Liberti que ce sont les terres les plus fertiles qui sont transférées aux investisseurs, qui les transforment en exploitations en monoculture, sans considération pour les populations locales, et en créant finalement peu d’emplois.
Liberti reconnaît que des efforts ont été faits par certains gouvernements (comme la Tanzanie) et la Banque Mondiale pour encadrer ces investissements par des règles éthiques, mais il s’agit juste de recommandations non contraignantes juridiquement (donc souvent contournées) et qui ne vont de toute façon pas assez loin.
Sa conclusion est claire : les zones rurales dans le Sud sont la proie d’un nouveau colonialisme : “Comme aux temps coloniaux, les puissances chassent les ressources dont elles ont besoin : nourriture pour leur population et carburant pour leurs voitures”.
Liberti n’accuse pas seulement les investisseurs peu regardants sur leur impact mais aussi les gouvernements locaux, coupables de ne pas prendre soin de la partie la plus pauvre de leur population.
Ce livre, qui se lit comme du journalisme d’investigation, est passionnant. En même temps, il ne suggère pas de voie qui permettrait d’enrayer le mouvement ou de le mettre sur un chemin plus éthique. Il semble tout de même que l’auteur privilégie la piste d’un cadre juridique plus contraignant, comme celui proposé par O. de Schutter, le rapporteur spécial des Nations Unis pour le Droit à l’Alimentation.
